<REVISTA
TEXTO DIGITAL>
ISSN
1807-9288
-
ano 5 n.2 2009 –
http://www.textodigital.ufsc.br/
LA POÉSIE
NUMÉRIQUE UN OBJET D’ESSAI TRIADIQUE
Wilton Azevedo
Université Presbiterian Mackenzie
Résumé :
Dans cette ambiance nous observons, dans les dernières
années, qu’il n’y a pas de collision de codes. Nous voyons leur mouvement
d’expansion – l’écriture en expansion. La
sémiotique de C. S. Peirce (1977)[1],
en l’acceptant comme une triade, qui part vers un système rhizomatique, pas
tout à fait dual et moins encore diachronique, ce qui dans la pensée de Peirce
finit par déconsidérer le sens manichéiste entre : l’erreur et la
justesse, l’étrangeté et la répétition, l’abstrait et le figuratif. Si nous
regardons donc l’action de n’importe quel signe, il sera toujours immensurable
et il ne peut y avoir, dans son processus d’expansion, cette division où un
signe engendre un autre signe.
Quelques
indices nos signalent, pendant ces années-là, que les systèmes de langage programmatique
formatent notre planète de façon à nous tendre des pièges, car l’implantation
de l’internet, les portables, les TV plasma interactives ont fini par apporter
un nouveau sens au verbe
« lire ». Cet état éphémère nous fait perdre la dimension de
l’écriture hypostatique et comme il ne s’agit pas d’un texte de rhétorique
linéaire, les changements culturels se font dans la façon que l’humanité passera à acquérir les
connaissances.
La poésie numérique
et surtout le poème numérique servent d’expérimentation, en entrainant de
nouveaux récits et discours dans l’hypermédia – que j’appelle Interpoesia[2]
– pour que, dans le déroulement de la pensée du parcours des signes plongés
dans cette ambiance de l’écriture numérique mettent en question le sens de la
compréhension et de l’éloquence.
Dans cette
ambiance nous observons, dans les dernières années, qu’il n’y a pas de
collision de codes. Nous voyons leur mouvement d’expansion – l’écriture en
expansion – qui n’appartient plus à de codes isolés dans leur espace temporel,
mais à un temps/espace de signes, qui travaille avec l’articulation et le
registre de signes multi-dimensionnés en espace/temps, lequel n’est plus
bidimensionnel, paradigmatique, formé par des processus syntagmatiques.
C’est pourquoi
on doit reprendre la sémiotique de C. S. Peirce (1977)[3], en l’acceptant
comme une triade, qui part vers un système rhizomique, pas tout à fait dual et moins encore diachronique, ce qui
dans la pensée de Peirce finit par déconsidérer le sens manichéiste
entre : l’erreur et la justesse, l’étrangeté et la mesmice l’abstrait et
le figuratif. Si nous regardons donc l’action de n’importe quel signe, il sera
toujours immensurable et il ne peut avoir, dans son processus d’expansion,
cette division où un signe engendre un autre signe.
Dans la poésie
numérique, les codes ne se divisent plus diachroniquement dans le concept de mesmice et d’étrangeté, de fiction et de
réalité, comme prévu dans les manifestes du siècle dernier. On a insisté
tellement sur ces ruptures que l’art a fini par créer, dans l’invention de la
performance, quelque chose qui rendait le langage poétique vulnérable au
registre historique – hic et nunc –
et ainsi, toute et n’importe quelle manifestation artistique ne demeure plus au
service, ni de la fiction, ni de la réalité : elle serait valable
uniquement réalisée dans le présent– real
time. De cette façon, la poésie
numérique devra être revue, en tant qu’environnement de signes qui
s’articulent, ainsi que la parole et la musique, en opérant dans une somation
d’environnements : l’ambiance. Dans le sens sémiotique, le « faire
signe » de la poésie numérique devient visible d’une manière indicielle
par rapport au modèle mathématique
adopté.
Pour le développement
de la poésie numérique, il faut qui nous nous concentrons sur une révision
concernant la poésie et la littérature qui employait déjà la syntaxe non
linéaire – parataxe – comme une actualisation des préceptes connus par le
domaine des lettres, mais avec une nouvelle notion de rythme, de récit et de
discours. L’espace délimité par le temps et l’espace littéraire et poétique
(Zumthor, 2007), issu de la pratique des rhapsodes
du Moyen Âge, est quelque chose qui vient de très loin et s’est accentuée
pendant le XVIIe et le XVIII siècles jusqu’à nos jours. La poésie qui acquiert, à partir de cette caractéristique
historique, une culture anthropologique, est mise en question face à la poésie
programmatique.
La grande
dichotomie, qui doit alors être surmontée, commencerait avec :
l’oral/l’écrit (Zumthor, 2007. Pag.13), par l’imagé/le canonique et le
sonore/le chiffré, où tout espace numérique, vu qu’il opère dans les concepts
de la simulation, nous transmet une sensation d’artificialité. Cependant, tout ce
qui passe par notre cognition – raison perceptive – ne peut être considéré
comme simple abstraction :
Il me
semble, tout au moins, que je peux dire : ce qui se perd tout de même avec
les médias, et qui demeurera
nécessairement ainsi, c’est la corporéité, le poids, la chaleur, le volume réel
du corps, dont la voix n’est qu’une expansion (Zumthor, 2007 page 16).
Je suis en
partie d’accord avec Zumthor, car à chaque jour le monde numérique se
corporifie aussi dans sa manière d’accès et d’expression, et ce n’est pas seulement la voix – le son – qui gagne son
expansion de signe, mais n’importe quel code, qui avait déjà, avant de devenir
logiciel, des caractéristiques virtuelles, comme c’est le cas de la parole. Si
cette donnée corporelle a lieu aussi dans son expressivité programmatique, dans
les aspects d’adaptation de ces codes – verbal, sonore et visuel, ses aspects
épistémologiques aussi bien que la dichotomie entre diachronie et synchronie
disparaissent. Nous ne pouvons pas
oublier que cette écriture est engendrée par un programme, qui doit être
préconçu comme écriture pour exister. Nous étions habitués, par la culture
technologique antérieur, à usurper le côté pratique et performatif du code,
mais si nous restons attentifs à ce concept nous nous rendons compte que
programmer est créer une performance. Cette expansion inter-codes a permis, par
l’intermédiaire de la nomenclature de programmation (stage, cast, member, behavior) de logiciels tels que Director MX de Adobe, l’option de
programmer l’action et la simulation.
Nous
commençons à modifier la façon d’acquérir les connaissances, le concept
d’écrire, d’ouvrir ce genre de poésie. En plus d’être dans l’âge de
l’expérimentation, nous sommes fruit de tout cela, modifiant le principal de
cette histoire, à savoir : Qu’est-ce qu’être poète ? Je n’ose pas répondre
ici, mais je me sens à l’aise pour dire que l’art et la poésie gagnent de plus
en plus un même espace dans cette expansion de signes, en réduisant la
distance, l’espace entre eux. Rien dans le milieu numérique ne se manifeste de
façon isolée, il n’y a pas de réintroduction d’éléments chaogènes ou redondants, tout est fruit d’une écriture programmée,
une écriture en expansion.
La poésie
numérique, aussi incroyable qu’il puisse paraître, reprend la ritualisation du
langage, car elle est un faire préprogrammé qui est prévu par son écriture et
c’est ce crédit qui l’émancipe en tant que nouveauté. Toute pratique de cet
exercice devient poétique, une poétique qui ne survit pas sans être précédée
par une écriture. Dans cette circonstance, le poète numérique travaille avec
les contradictions de ce programme numérique, concept développé – Looppoesia[4] –, en
puisant dans cette écriture mathématique
randomisée, mais figée, ce qu’elle peut nous offrir en tant que signe de
lecture et d’interprétation de langages de programmation. Le poème peut donc
être dépourvu de mots, car l’énonciation n’est pas dans le discours, le récit
ne raconte pas d’histoire. Ce qui est poétique est l’expansion des
signes : faire de la poésie numérique est construire des environnements –
des ambiances – en mutation constante, une expérience qui n’a pas le souci de
créer de formules.
Le mot
aujourd’hui suit un processus qui ne peut être plus le seul signe qui
représente l’objet des connaissances.
Dans le monde cyber la mémoire n’appartient pas à l’espèce humaine : qui
est le sujet qui parle, enfin, qui est le sujet ? Les connaissances et leur acquisition
découlent du savoir : elles ont créé une culture sémiotique transformant
le concept d’intellection.
La transformation qu’a soufferte l’acquisition
des connaissances scientifiques en d’autres domaines a rendu le dialogisme
scientifique une prémisse pour de nouvelles découvertes. Ce que nous
connaissons alors par langage appartient dorénavant à la biologie, la physique,
la chimie…, dans le sens de comprendre son processus logique et de signes de la matière.
Par
contradiction, et un positivisme persistant, la linguistique est demeurée
éloignée de ces changements, sauf les études de
Norbert Wiener[5], Max Bense et
Claude Shannon, rien que pour nommer quelques-uns qui ont contribué, par leurs
découvertes, à l’étude de la théorie de l’information et à celle des fréquences
des mots, une étude qui a eu de l’importance pour l’éclosion de la Poésie
Concrète, de la Poésie Visiva en Italie, et des Calligrammes, mais qui n’a
envahi ni le monde de l’écrite ni celui de la littérature, comme nous pensions
qu’il pourrait arriver.
Dans ce sens,
la poésie numérique est la dernière instance pour servir de démarcation à la
signification linguistique. La poésie numérique ne la limite pas, parce qu’elle
fait partie d’un système qui se produit dans plusieurs directions, pareil à
notre quotidien. Il n’y a rien de
spécifique dans son discours, et voilà la difficulté de repérer son
comportement linguistique.
La diversité
de l’ambiance numérique, qui crée des conditions pour l’apparition de
l’écriture en expansion, peut être ambiguë pour ceux qui ne comprennent pas ce
langage n’appartenant pas seulement aux signaux verbaux comme le dit Julia
Kristeva :
On a
soulevé plusieurs fois la question de savoir s’il existe un langage sans pensée
et une pensée sans langage (Kristeva, 2007, page 16).
Il ne s’agit
pas d’avoir une pensée qui ne concerne pas la linguistique, ce code-ci ou
celui-là, mais plutôt de savoir comment demeurera l’acquisition du savoir
poétique dans ces nouveaux systèmes de production de langage sémiotique.
Le savoir
poétique est l’acte cognitif qui nous fait partenaires de ce processus. Nous
commençons à articuler d’autres systèmes de signes concernant les échanges de
ces signes, qui ne sont plus diachroniques dans le jeu sémiotique de la poésie
numérique. Dans ma compréhension, cet échange a lieu dans un système plus triadique que dual, issu du matriciel du langage. La condition de la
programmation qui est encore le principe qui engendre la signification, ne fixe
pas la qualité de cette écriture.
1.1. WLADEMIR DIAS PINO et LE POÉME PROCESSUS
Comme le
signale James O’Donnell (2000), même avec l’invention de l’imprimerie et avec
tous les changements technologiques de la reproduction, nous n’avons pas réussi
à modifier certaines choses essentielles de ce dispositif qu’est le livre :
A pesar
de que hubo interrupciones profundas, la
comunidad fundamental de productores y usuarios de textos permaneció bastante
fija: el clero y los aristócratas. Algunos
ex monjes se convirtieron seguramente en profesores de universidad
(Lutero es uno ejemplo claro), pero la continuidad de la comunidad de textos se
intensifico al máximo. El códice conservo la forma externa del libro y las
técnicas que explotaron su poder en los últimos años de una cultura
exclusivamente manuscrita fueron perfeccionadas y no sustituidas. (O’Donnell, 2000: 49-50)
Les
expérimentations ont toujours été ouvertes au dialogisme entre la mesmice et l’étrangeté, et une fois que
ce conflit disparaît après le langage numérique demeurer comme supporte de la
production poétique, il y a aujourd’hui un espace international contemporain,
surtout après les poèmes concrets.
Le souci
concernant la poésie et ses conséquences poétiques se présente toujours à
l’égard de leurs structures et de combien la nouveauté dans la création de signes
lui apporterait pour être acceptée comme avant-garde.
Wlademir Dias
Pino (Dias Pino S/d) ouvre cette discussion en ayant mis son accent davantage
sur son époque, quand il commence à développer l’idée du poème processus en
tant que concept de déplacement, dans lequel il propose que le besoin d’un
poème d’avoir des variations de sa propre solution impose au processus poétique
d’admettre différentes structures de dispositif : le processus devient le
poème et non plus la poésie :
Il n’y a
pas de poésie-processus. Ce qui existe est le poème-processus, car ce qui est
un produit, c’est un poème. Celui qui enferme le processus est le poème. C’est
le mouvement ou la participation créative qui amène la structure (matrice) à la
condition de processus. Le processus du poète est individualiste, et ce qui
intéresse collectivement est le processus du poème (Dias Pino, S/d).
Pour moi, en
faisant une analyse plus attentive dans ce qui concerne le concept
d’hypermédia, tout ce que le poème processus porte en lui est lié aux variables
informationnelles, pour que le poème atteigne un stade d’autophagie et qu’il
soit capable de s’auto dépasser. Pour ne plus compter avec l’importance de
l’ordre alphabétique, dans ce cas, le mot n’est plus nécessaire, ce qui le rend
plus ouvert, et il ne se fixe plus spécifiquement en tant que
langue :
Il ne
s’agit pas, comme certains pourraient le penser, d’un combat rigide et gratuit
contre le signe verbal, mais d’une exploration planifiée de possibilités
comprises en d’autres signes (non verbaux). Il est intéressant de rappeler qui
même les structures ne se traduisent pas : elles sont codifiées par les
processus qui visent à la communication internationale. (Dias Pino, S/d)

Livre-objet AVE de – A AVE de Wlademir Dias Pino – Cuiabá, Brasil,
Igrejinha, 1956.

La Manipulation du Livre-objet A AVE de Wlademir Dias Pino
1.2. Poésie ou
poème numérique
Cette
affirmation est d’extrême importance parce que Dias Pino développe ici l’idée
que l’écriture n’appartient pas seulement au code verbal. Je sais
qu’aujourd’hui c’est presque redondant de faire une telle affirmation, mais
elle est issue de ce livre publié en 1972 [6] et qui avait déjà
été écrit bien avant. C’est ici qui nous avons des indices de que sa poésie –
ses idées – s’approche plutôt du concept d’hypermédia que de la poésie
concrète, à tel point qu’il se laisse
aller dans le risque d’une taxonomie qui nous amène à penser le poème numérique
et sa programmation comme processus.
Dias Pino
démontre comment peut opérer, du point de vue sémiotique, un indice
qui présente le sens d’écriture :
Code : partie – stade d’un
poème structure satellite : retardateur (de lecture mécanique du cerveau
humain pour une information géométrisé : électronique)
Combinaison : une relativité.
Mot : Fixation verbal
Slogan : Phrase-verbal
Fragmentation : Utilisation
de détails de lettres-explosion typographique.
Didactique : Pour
l’apprentissage du poème.
Poèmes sans mot : Poèmes non
typographiques (fin du modernisme).
Nouvelles graphies : charades/tests.
Graphiques : géométrisation ;
animation/circuit : exercices formés
d’image /collage ;
documents quotidiens.
À partir de ces concepts
taxinomiques développés par Wlademir Dias Pino en ce qui concerne le poème
processus, je propose ici une actualisation vers l’environnement
numérique :
Code : Registre mémoriel,
Exercice poétique
Expansion de signes
Écriture Numérique : programmation /logiciel
Avatar : Une entité créée dans un
milieu digital qui assume un corps de signes.
Relation de participation : Ambiance passive, réactive et interactive.
Opération : Articulation
et non manipulation.
Manipulation : Physique, matérialité.
Articulation : virtuelles, signaux,
syntaxe, écriture de programmation
générative.
Processus Interactifs :
Processus Interactif Cognitif :
La Formation
de signes mentaux interprétatifs ne modifie pas le processus d’articulation de
l’émetteur, elle rend seulement les
signes passibles d’interprétation, de/une volonté de significations établies
par la syntaxe des signes.
Processus : Auto-acquisition
Processus Interactif d’Intersection: Ensemble de signes où un code fait l’intersection de l’autre – il se
configure par deux ou plusieurs codes qui se superposent – le changement
d’articulation a lieu par permutation de
cette intersection – intersigne[7].
Processus : Acquisition
collective.
Processus Interactif d’Intervention : Processus de signes en expansion en intégrant espace/temps dans tous les
codes. Cet item modifie, il interfère, il dilate, en empêchant le maintien d’une signification
stable.
Processus : Acquisition
Transitoire.
Cet indice nous permet de
penser qu’un poème se fait d’une expérience, et je dirais encore : par l’expérimentation,
en envisageant toute forme graphique, comme de nouvelles clés lexicales, en
tant que processus qui s’auto-transforme, vu qu’il n’est pas rattaché seulement
au mot ou signe indiciel, mais plutôt à
l’iconique, c’est-à-dire, celui qui a une donnée imagée selon C.S.Peirce
(1972).
Pour que l’on
comprenne mieux, j’oserais proposer ici un petit schéma concernant tout ce qui
a lieu dans les étapes de l’écriture numérique :
Écriture Matricielle Numérique Lisible – (EMNL)
Ces frontières
matricielles, on peut les vérifier par l’histoire même du code adopté, qui
s’est servi d’une technologie pour devenir une écriture. Par exemple,
l’invention de l’écriture comme forme de mémorial de l’histoire, le
magnétophone comme mémorial de l’oralité, l’appareil photo comme mémorial
visuel, le cinéma comme mémorial du mouvement.
Ainsi les
codes se sont servis et se servent encore de leur crédibilité non seulement
comme mémorial, mais dans l’exercice de la crédibilité, et également dans la
forme poétique.
Les frontières
établies par l’écriture matricielle, même si elles ne créent pas une parataxe –
chevauchement – vont permettre un progrès vers un autre modèle de signes
intercodes. Le dialogisme existe ici, une fois que s’est établi un contact avec
un autre code.
Cette forme
d’écriture porte en soi toute la culture de registre mémoriel humain, par
l’intermédiaire de ses signes conventionnels chiffrés : verbal/fixe ou
mobile, imagé/2D ou 3D, et sonore/musical. Ces codes séparés par convention de
leur propre histoire ont eu, chacun, pour leur visibilité et compréhension,
leur technologie employée pour leur dissémination.
Les moyens
d’information, tels que les journaux virtuels, travaillent avec ce concept, par
la tradition même de l’environnement imprimé qui a conquiert sa
crédibilité : le son, l’image et le texte sont disposés de façon bien
claire et leur matrice est opérée de façon indicielle, autrement dit, de
manière à ressembler au journal imprimé.
Écriture Matricielle Numérique Intermédiaire (EMNI)
Dans ce cas,
les frontières établies par l’écriture matricielle ont aidé à promouvoir une
parataxe dans l’écriture numérique – des signes qui opèrent par chevauchement.
Cette progression n’est permise que pour ce deuxième item. Le contact se fait
par intersection de deux codes.
Ici nous
remarquons déjà une opération intercode d’un code qui pénètre un autre code de
manière intersectée, où l’un prend de l’autre, les caractéristiques de signes
qui ne font pas nécessairement partie de sa matrice. L’intermédiation à
laquelle je fais référence, n’est pas quelque chose qui change la
configuration, déforme la perception des trois codes en question, lesquels
peuvent encore être détectés dans leurs caractéristiques. C’est juste
l’intersection entre eux qui crée une espèce de poly-sémantisme, pourtant bien
plus complexe, car cette intermédiation a lieu dans l’ambiance numérique d’un
programme.
Écriture Numérique en Expansion (ENE)
Cette dernière
est, pour moi, celle qui caractérise la plupart des poésies numériques. Il n’y
a plus de code prédominant ; l’ambiance est son-texte-image, ou comme l’a
dit une fois Décio Pignatari une poésie « verbivocovisuelle ». Je sais qu’il faisait référence à une
partie de la poésie concrète qui a toujours eu lieu dans l’espace
bidimensionnel, mais qui convient ici, parce que ses matrices chiffrées
disparaissent, survivent en forme de programmation admettant le processus en
tant qu’écriture numérique en expansion, par la façon même dont le programme
opère, sans distinction entre le son, l’image et le texte.
On remarque
dans cette triade qu’il n’y a pas de signes prêts, définis par le symbolique
qu’il répercute ou instaure. Les signes sont overlappings qui se refont en processus redondants de sémiose ou
qui surgissent en tant que phénomènes – phénoménologie peircienne – et ils
présentent à chaque instant une circonstance toute neuve et inespérée. Les
manifestations de langages et leurs productions poétiques dans le processus
d’expansion dans cet environnement, qui n’est plus bidimensionnel, nous placent
face à un signe qui n’est jamais prêt, à un interprétant final qui restaure sa
qualité de signe – iconique –, à un signe qui est en expansion dans une
direction non fermée, brisant ainsi la chaine de l’altérité, l’Autrui, ou comme
le dit Tavares (1999), de l’image de l’étranger.
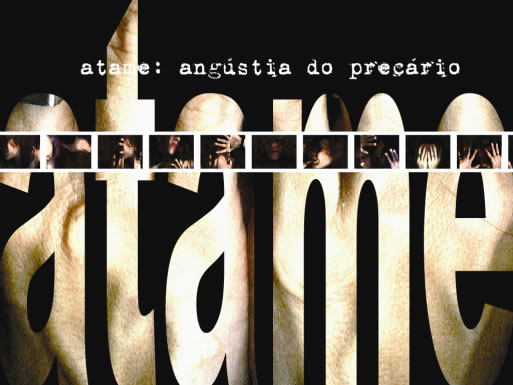



ATAME : L'angoisse du précaire – 2007/08 –Wilton Azevedo
L’imitation,
la mimesis de l’ENE est un processus
programmatique de pure simulation du faire et de représentation dans
l’expérimenter. Je cherche ici à ne pas employer le verbe lire, puis
qu’aujourd’hui ce verbe n’a plus la signification sui generis rattaché au code verbal. Ce que j’ai cependant appelé
expérimentation au long de ce travail établit que l’acte de réception est aussi
de nature en expansion.
Une
carte routière, par exemple, pour toutes les fins pratiques, est d’une façon
quintessent, une chose bidimensionnelle, un plan. Elle emploie deux dimensions
pour transmettre des informations d’un genre précisément bidimensionnel. En
vérité, bien sûr, les cartes routières sont tridimensionnelles, comme tout,
mais leur épaisseur est si mince (et tellement
sans relevance pour son but) qu’elle peut être oubliée. En effet une carte
routière demeure bidimensionnelle, même lorsqu’elle est pliée. De la même
manière, un fil est vraiment monodimensionnel, c’est une particule qui n’a
aucune dimension (Greick, 1991, page 92).
La poésie
numérique ne se préoccupe pas d’un but, dans le sens du défi conclusif, mais
elle a plutôt le souci d’être une ligne en expansion à la recherche de
l’expérimentation.
Les
locaux pour l’habitation étaient appelés mégaron
polythyron, composés, en bref, de deux espaces qui communiquent entre eux
par une série de portes qui, si elles
veulent rester ouvertes, créeront un seul environnement (Santarcangeli, 1997,
page 91).
La poésie
numérique laisse plus évident à chaque étape, que la redondance de ses
articulations de signes se fait présente en tant que poétique. Elle n’est pas
pourtant la redondance engendrée par la culture POP, mais plutôt l’exhaustion,
l’excès, en tant que processus d’étrangeté créant des extensions de ses signes
sans plus avoir besoin de compter les mots.
Il y a toute
une trajectoire de spéculations autour du comportement interdisciplinaire et
des combats engagés par la survivance de la science et de la poétique.
J’observe néanmoins que, dans ce siècle, il sera inévitable que nous pensions à
de nouveaux outils d’analyse, parce que la poésie numérique en tant que produit
hypermédia et de nature plurielle comporte d’autres sciences outre la
sémiologie linguistique. Dans tout ce que nous comprenons par discours, nous
pouvons encore dire que nous faisons de la poésie, et ce faire est un processus
sémiotique. La recherche maintenant doit se tourner vers l’expérimentation
poétique qui grave sa signification, raison par laquelle nous nous acculturons,
c’est-à-dire, les codes et leurs dispositifs traditionnels s’acculturent.
Toute
invention de performance de l’avant-garde poétique, le temps et l’espace –
chronotropo poétique – la poésie a été soumise pendant des milliers d’années
dans l’espace bidimensionnel du papier, même si plus tard les nouveaux
environnements électro-électroniques ayant surgi, leur spatialité a toujours
été une sorte d’illusion de notre
perception.
Bibliografie
Dias
Pino, Wlademir.
Processo: linguagem e comunicação.
Rio de Janeiro: Vozes.
GREICK, James. Caos: A
criação de uma nova ciência, Tradução de Waltensir Dutra Rio de Janeiro:
Campus, 1991.
KRISTEVA, Julia. História da
Linguagem. Edições 70 Portugal,
LisboaLAUAND, Luiz Jean (Org.). Cultura e educação na Idade Média. São
Paulo: Martins Fontes, 1998.
O’Donnell, James. Avatares de
la palabras: del papiro al ciberespacio. Buenos Aires: Editorial Paidós, 2000.
Pierce, Charles Sanders. Semiótica. Tradução José Teixeira Coelho
Neto, Coleção Estudos. São Paulo: Perspectiva, 1977.
Santarcangeli, Paolo. El libro de los laberintos: historia de
um mito y de um símbolo. Prólogo de Humberto Eco. Ediciones Siruela, 1997.
TAVARES, José, Fernando. Para uma
Poética da Leitura. Literatura e Teoria. Universitátria Editora. Lisboa,
1999.
Zumthor, Paul. Performance,
recepção, leitura. 2a ed. Tradução Jerusa Pires Ferreira e Suely Fenerich. São
Paulo: Cosac Naify, 2007.
<REVISTA
TEXTO DIGITAL>